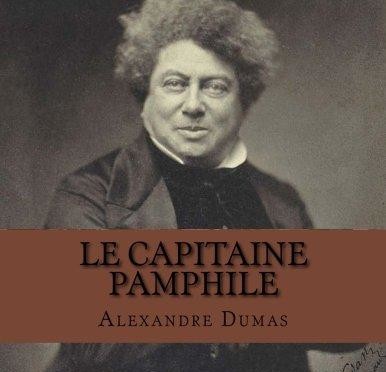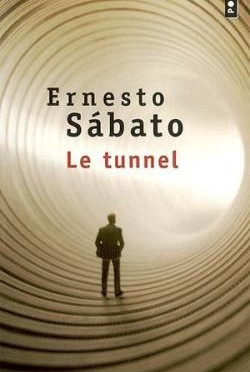32º Salon de la Revue – Paris, 16 octobre 2022
Comment est née l’idée de créer le salon de la Revue?
Je n’étais pas encore là, mais je peux vous donner quelques pistes. L’association Ent’revues est née en 1986, du constat de l’absence d’un lieu qui puisse commenter, qui puisse récolter, qui puisse compiler les informations sur le monde de la revue. Il existe une tradition tant en France qu’à l’étranger, c’est une citation d’un des créateurs d’Ent’revues, Olivier Corpet, disparu il y a un peu moins de deux ans. Il n’y avait pas de lieux vraiment pour parler de revues spécifiquement et, lorsqu’Ent’revues est née au sein de la Maison des sciences de l’Homme à Paris, très vite s’est faite l’idée d’avoir un vrai territoire, de se référencer, et puis de les aider à se montrer. À l’époque, elles avaient déjà des difficultés à se faire voir, se faire connaître dans les librairies et les bibliothèques et, quelques années après la création d’Ent’revues a eu lieu le premier Salon à l’École des Beaux-Arts de Paris, qui réunissait des revues de genres aussi variés qu’aujourd’hui ici au Salon de la Revue aux Blancs-Manteaux.
Quels sont les principaux problèmes par rapport à la préparation du Salon de la Revue?
Je ne vais pas vous parler des affres et du stress concernant sa préparation puisque c’est un travail au long cours. En fait, l’association Ent’revues repose sur trois pieds, c’est un triple axe avec, d’abord, l’annuaire, qui dorénavant existe en ligne, sur notre site et qui recense quelques 3000 – 3200 références et qui peut attester de la vivacité des 2500 revues culturelles francophones vérifiées chaque année. Donc, le site d’Ent’revues ; la publication de la Revue des revues, qui est une publication savante qui donne une place à des nouvelles revues, par exemple, des chroniques de lecture ; le troisième c’est, donc, la préparation du Salon de la Revue. C’est quelque chose qui se prépare très en amont. On ne va pas parler de toutes les difficultés liées au COVID-19. La difficulté viendrait plutôt, et là je parle du stress actuel qui anticipe déjà la fin du Salon, de cette forme de rétrécissement de l’espace public à coups de fréquentation, d’assurances à prendre. Nous sommes dans ce lieu magnifique que nous habitons depuis vingt ans, c’est le 20eme anniversaire du Salon aux Blancs-Manteaux, au cœur de Paris, et merci encore, d’ailleurs, à la mairie de Paris Centre qui nous accueille. Et, simplement, chaque année on a un peu moins de temps pour s’installer et rendre les lieux conformes à leur usage habituel (c’est un gymnase pendant la semaine) et je dirais que c’est surtout ça la difficulté, mais, en même temps, on est ravis d’être là juste un week-end, mais on se demande « pourquoi pas un jour de plus ? ». D’abord, c’est plutôt qu’un gymnase au cœur de Paris le reste du temps, avec ses habitudes, ses plannings, ses calendriers, et, puis que les revues, pour beaucoup, sont des objets vraiment fragiles, artisanaux, et ses éditeurs font une vie à côté, une revue est rarement riche, ça se saurait sinon. C’est peut-être aussi cette idée-là de quelque chose de précieux et que les gens qui en font ont souvent un métier à côté, ce qui rendrait fastidieux et coûteux pour ceux qui viennent de loin le fait de venir, cela revient toujours à une question de temps.
Est-ce qu’il y a des critères spécifiques pour choisir des revues qui participent au salon de la revue ?
Pas du tout. Aucun critère. Ce que je veux dire, c’est que l’entretien du site est une veille quotidienne, par exemple nous avons cherché et découvert les revues, en librairie, par les réseaux sociaux, etc. et nous inscrivons ces revues, francophones culturelles, de création littéraire, les revues de recherche, universitaires, sciences humaines, la philosophie, la psychologie, etc. du moment que l’on atteste de l’existence de cette revue en papier, en ligne, ou dans les 2 versions, on la référence sans même demander son avis. Il nous arrive d’envoyer des messages pour obtenir des informations, des références la couverture du dernier numéro par exemple. A partir de cet annuaire de 2500 références, pour peu que les adresses courriels soient valides. On envoie le même message d’information d’ouverture des réservations à de toutes les revues présentes, que ce soit une petite revue artisanale et fragile crée dans une région de France jusqu’à La Nouvelle revue française ou la revue Études. La difficulté étant que ce seul mail n’arrive pas forcément dans les courriels, on ne sait pas s’ils les reçoivent et, ensuite, ce qu’ils font avec cette information, mais il n’y a pas le choix préalable. Simplement, c’est vrai qu’on peut noter de grands fidèles qui sont un peu le substrat de ce salon et chaque année habituellement, en tout cas avant les trois ans, on constatait un renouvellement entier des exposants, certains revue choisissant de passer leur tour mais qui ne prévoyaient pas de nouveautés dans l’année à venir pour des raisons diverses. Vous voyez, ça se renouvelle comme cela à peu près tranquillement avec aussi malheureusement des revues qui disparaissent et des revues qui naissent très peu chères qui est en valeur de démontrer le salon.
Quelle est la place de la revue numérique dans le salon et comment est-elle évolué au fil du temps?
Certaines revues, d’ailleurs existent depuis très longtemps, la plus ancienne ancrée en Suisse, Les Belles-Lettres, existe depuis 1832, j’espère que je ne me trompe pas, en tout cas au 19ème siècle. La place de la revue numérique n’est pas très importante, disons que ça n’est pas un lieu de résistance… Nous accueillons des portails de revues en lignes plutôt des revues universitaires telles OpenEdition Journals, et de la revue purement électronique qui vient depuis une vingtaine, une quinzaine années. Nous avons très vite considéré ces revues comme à peu près sinon les les égales au moins elles devaient avoir la même attention de notre part étant un lieu de création notamment de création numérique avec ce rapport au texte, pas des revues d’art spécifiquement, mais des revues qui parlent de l’art par la critique, par la théorie, par exemple, des revues qui mêlent l’art et le texte. Et pour ce qui est de la revue électronique, il y a une vingtaine d’année on a accueilli leur émergence et il se trouve qu’il y avait par exemple beaucoup d’expériences en ligne de création et de réflexion sur l’émergence du texte littéraire sur un écran et puis très vite la mode du blog est venue unifier le format, ce qui nous dit rien de la qualité des textes présentés, qu’ils soient théoriques ou littéraires, mais ça avait normalisé les formes. Je pense que c’est peut-être pour ça que des revues tenaient moins à venir se montrer ici au Salon de la Revue alors même qu’elles avaient la même information que tous et qu’aujourd’hui finalement, vous pouvez trouver au gré des années par exemple Ouropode, et il y a 4 ou 5 revues numériques qui prennent un petit stand car elles n’ont rien à vendre. Mais ce n’est pas un refus de les présenter ici mais je crois que pour elles, c’est la trame, le réseau qui est leur terrain d’action. Et ainsi, il y a ces revues, mais elles sont moins nombreuses. Je sais que cette réponse n’est pas très satisfaisante pour Sens Public. Mais Sens Public a développé aussi d’autres formes de publication des textes et un attachement au papier qui explique sa présence fidèle au Salon de la Revue.
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous répondre.