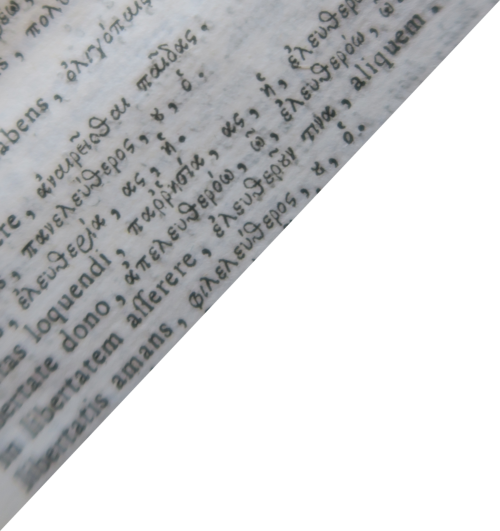Réalisme et anti-réalisme: quelques notes sur la métaontologie
Je me livre ici à un exercice un peu extrême qui implique nécessairement de s'exposer à des critiques - et aussi au ridicule. Mais ceci n'est pas un article. Juste des notes pour préparer un texte que je voudrais écrire un jour et que je n'écrirai probablement pas...
On peut lire l'histoire de la pensée comme une succession d'oppositions. C'est, du moins, ce que fait Aristote dans la Métaphysique, lorsqu'il nous offre le premier modèle d'histoire de la pensée en Occident. Les «naturalistes» s'opposent sur la base de l'élément qu'ils choisissent comme principe premier (l'eau, le feu, l'air...). Parménide et les éléates s'opposent à Héraclite, les premiers pensant que tout est immobile et le second affirmant que tout est en mouvement. Lloyd, dans son ouvrage Polarity and analogy, montre bien comme le principe de l'opposition est à la base de la rationalité grecque et suggère d'ailleurs que cette structure pourrait avoir aussi une valeur comparatiste. J'ajouterais que la notion d'analogie n'est compréhensible qu'à partir de celle de polarité et que, finalement, des formes radicales d'analogie, comme par exemple la métaphore, ne sont qu'une tentative de dépasser un principe omniprésent dans notre langage, le principe de non-contradiction.
C'est à partir du principe de non-contradiction que l'on peut interpréter ce récit binaire de l'histoire de la pensée: deux affirmations contradictoires ne peuvent pas coexister, mais elles existent pourtant. Voilà pourquoi nous sommes portés à diviser en deux le monde, en factions opposées et inconciliables. Les réalistes et les idéalistes, les essentialistes et les nominalistes, les empiristes et les constructivistes... Qu'il s'agisse de la querelle des universaux (qui a traversé sous différentes formes l'histoire de la pensée occidentale d'Aristote à nos jours) ou de la querelle moderne sur la notion de représentation, on peut retrouver cette structure d'opposition un peu partout. On dirait presque que la pensée elle-même n'existe qu'à partir d'une opposition qui questionne et que nous nous sentons obligés de réconcilier sans jamais y parvenir. Bien évidemment, il s'agit d'une façon de raconter l'histoire de la pensée, ce n'est qu'un récit, et ce récit ne tient pas compte des spécificités complexes et des nuances fondamentales qui différencient une approche particulière d'une autre.
Dernièrement je relisais des notes prises pendant les cours d'un des penseurs qui ont le plus influencé ma formation universitaire, Francesco Orlando. Ce théoricien de la littérature, mort en 2010, aimait particulièrement se prêter à l'exercice auquel je me livre ici. Il avait la capacité de dresser de grands portraits de l'histoire de la pensée en quelques mots. Il le fait, par exemple, dans un longue entretien disponible en vidéo et en transcription (en italien, publié dans Enthymema, I, 2009). J'essaie de le résumer. (Résumé d'un résumé: l'histoire du monde résumée en quelques minutes, résumée ensuite en quelques mots). Il est intéressant que ce penseur très productif n'ait jamais eu un impact significatif en France, en dépit du fait qu'il était avant tout un spécialiste de littérature française. Dans cet entretien - comme souvent dans ses cours, dans ses textes et dans nombre de conversations privées - l'objectif d'Orlando est d'expliquer la raison de ce manque de succès de sa pensée.
Selon Orlando, cela est dû au fait que son approche «rationaliste» ne peut pas avoir de place dans l'atmosphère profondément antirationaliste qui caractérise la France et, à cause de la diffusion d'une certaine pensée française au États-Unis, qui caractérise aussi le reste du monde à partir de la fin des années 60: un certain type de structuralisme et surtout de post-structuralisme incarné - selon lui - en premier par Derrida, Barthes, Foucault, Kristeva... Cette pensée, toujours selon l'interprétation d'Orlando, s'impose comme pensée dominante et reste telle jusqu'à aujourd'hui (au moins jusqu'en 2010).
Orlando affirme que la déconstruction de Derrida, ainsi que le structuralisme de Barthes, refusant toute référence du texte au monde et à la vie, produisent une forme radicale d'antirationalisme. Il n'hésite pas à parler de ces penseurs comme de charlatans. Il est sans doute difficile de mettre tous les penseurs français influents des années 70 dans un même groupe, et sans doute ces opérations d'assimilation de grands macrosystèmes se prêtent-ils à des critiques (ces résumés, en stylisant la pensée, finissent par faire dire aux auteurs des choses qu'ils n'ont pas dites: perdre les nuances finit par impliquer que l'on perd le fond). On pourrait citer, pour préciser tout ce débat, le livre de Cusset French Theory et toutes les querelles qui ont suivi l'affaire Sokal à partir de la fin des années 90. Cusset montre bien que les généralisations de la pensée d'une dizaine de penseurs français tels que Derrida, Barthes, Foucault, Deleuze, Kristeva, etc. sont dues au passage par la lecture qui en a été faite aux États-Unis et qu'il est impossible de penser ces auteurs comme s'ils faisaient partie d'une «école» (qu'on l'appelle post-structuralisme ou post-modernisme ou autrement). Il me semble cependant correct d'identifier une tendance dominante dans une certaine pensée qui arrive aux États-Unis sous le nom de French Theory: le discours ne renvoie qu'au discours, ou mieux, il n'y a que du discours. C'est une critique radicale de la notion de représentation et de mimesis, l'idée binaire selon laquelle il y aurait un monde et un discours sur le monde. Selon Orlando, c'est Auerbach contre Barthes.
Ce qui inquiète Orlando est le fait que cette pensée reste dominante pendant une trop longue période de temps. Il affirme (je traduis ): «Je vois l'histoire de la France comme une succession périodique de polémiques à partir du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle; si je pense que la culture française est finie, c'est parce qu'après 1960 il n'y a plus personne qu'on a mis au grenier, les gourous de 1960 sont encore les gourous d'aujourd'hui, et cela est un très mauvais signe; quand une chose pareille arrive en France, je sens une odeur de pourri.» (Vedo la storia della Francia come una successione periodica di polemiche dal 1600 al 1900; se penso che la cultura francese sia finita è perché dopo il 1960 nessuno più è andato in soffitta, i santoni del 1960 sono ancora i santoni di oggi e questo è un pessimo sintomo, sento odore di putrefazione quando succede una cosa simile in Francia).
Or, si la pérennité de ces supposés «gourous» n'est pas certaine (encore une fois, Cusset la met en question en disant que le succès de ces penseurs aux États-Unis correspond à un relatif «oubli» en France), il me semble qu'Orlando a raison sur au moins un point : il est indéniable que la destruction de toute forme de référentialité qui caractérise une bonne partie des approches théoriques de la French Theory pose un problème quant à l'identification d'une limite au constructivisme le plus radical. En gros, si tout est discours, il n'y a rien qui ne puisse être construit, la réalité est complètement fluide jusqu'à devenir inconsistante. On peut dire tout et son contraire.
La notion de représentation n'est pas à la mode aujourd'hui et semble même avoir été dépassée. J'ai moi même beaucoup écrit à propos de cela. Nous sommes dans une pensée de la performativité: le discours produit le monde et ne le représente pas. La réalité, quand elle réémerge, se présente au plus - à la Lacan - comme une simple limite: comme ce qui résiste au discours. Mais cette limite devient souvent imperceptible: il n'y a que la réalité que nous voulons bien créer. La question qu'il est donc nécessaire de poser est: comment éviter ce problème sans être obligé de revenir au modèle opposé du réalisme naïf? Peut-on être «rationnel» en se passant du concept de représentation?
La proposition d'Orlando est de parler de la coexistence nécessaire de ce qu'il appelle mimesis et convention. Tout discours est un discours sur le réel (il est donc mimesis), mais en tant que discours, il est obligatoirement issu d'une convention (et donc il a un aspect construit). L'exemple - un peu simpliste, je l'avoue - qu'il propose est celui d'une prise de vue d'une caméra sans opérateur. Ce qu'on verra dans la vidéo qui en résulte est la réalité (mimesis), mais le simple cadre est déjà une convention et empêche de considérer cette prise de vue comme une représentation «fidèle». Il n'y a donc jamais de représentation fidèle, mais tout est représentation et toute représentation est en partie construite et conventionnelle.
Cet exemple me semble un peu limité dans sa conception du réel. Je dirais que le simple fait de poser une caméra quelque part est un geste de production du réel et qu'il est très difficile de parler de réel sans avoir d'abord posé une caméra. Du coup, j'ai de la difficulté à affirmer qu'une prise de vue est une représentation - et je suis plutôt derridien en ce sens. Les pratiques numériques semblent me donner raison: l'aspect référentiel de la photo, par exemple, a tendance à disparaître à l'époque des photos prises avec des appareils portables. On ne prend pas une photo pour représenter quelque chose qui serait réel, on la prend pour produire le moment présent, pour dire qu'ici et maintenant il y a quelque chose qui se passe, pour produire l'existence du monde. C'est comme si l'on disait: voici mon monde, je le construis en le photographiant et j'en envoie la preuve sur le web pour qu'il devienne réalité. Ce qui est devant moi n'existe que parce que je l'ai photographié. La photo est un évènement.
Comme toujours dans l'histoire de la pensée, cette forme radicale de constructivisme n'est pas sans poser problème et semble inquiéter nombre de penseurs. Je prendrai l'exemple de Maurizio Ferraris et de tout le débat sur le «néoréalisme» qui a été très médiatisé en Italie dans les dernières années (Vattimo contre Ferraris, ou D'Agostini contre Ferraris). Ferraris essaie de revenir au réalisme à partir d'une approche derridienne. Il aime simplifier ce qu'il appelle le «néoréalisme» en disant: tout ce qui est social est discours, mais il y a des choses qui ne sont pas sociales et qui ne sont donc pas discours, par exemple un chat. À cela il ajoute quelque chose qui est à mon avis plus intéressant, ce qu'il appelle la «documentalité». Le discours, dit-il, n'est pas quelque chose d'immatériel, il existe seulement parce qu'il est inscrit. Ce qui est social est donc réel parce qu'il n'est qu'un ensemble de documents.
Des approches analogues à celle de Ferraris - qui dérivent sans doute aussi de la philosophie de Derrida - me semblent être particulièrement présentes dans les théories contemporaines. Il suffit de voir le succès de la notion de support (Bachimont, par exemple), de celle d'inscription (l'intermédialité), etc. En bref, on pourrait dire que le discours est réel, car il est toujours un objet matériel. Sans objet (livre, film, document légal...), il n'y a pas de discours. L'idée même d'un discours désincarné est une aberration.
La documentalité est donc une première limite à l'anti-réalisme. Mais étudier le discours ne signifie pas se livrer au constructivisme, car le discours est lui même une réalité «dure», qui oppose une résistance. À cela s'ajoute à mon avis un autre élément, que l'on retrouve dans la pensée d'Orlando: l'aspect logique. Le discours est toujours structuré à partir d'un certain nombre de macrostructures logiques. En particulier, l'idée d'Orlando est que certaines structures logiques peuvent être retrouvées derrière le travail de Freud et qu'on peut les utiliser pour comprendre en particulier les textes littéraires. C'est la thèse qu'il développe dans l'ensemble de son oeuvre et en particulier dans Pour une théorie freudienne de la littérature. En évitant toute approche psychologique, Orlando s'appuie sur le travail de Matte-Blanco (un autre inconnu dans le domaine francophone). Matte-Blanco, dans The Unconscious As Infinite Sets, essaie de reporter la pensée de Freud à une structure théorique de fond: à la logique du monde conscient, qui est la logique aristotélicienne, s'ajoute une logique qu'il appelle symétrique, qui est celle de l'inconscient. Des figures comme la métaphore pourraient être interprétées à partir de cette logique qui court-circuite les principes de non-contradiction, d'identité et du tiers exclu. Si dans la logique aristotélicienne toutes les relations sont non réversibles (A est père de B ne peut pas aussi donner que B est père de A, par exemple), dans la logique symétrique toutes les relations sont réversibles (et donc A est père de B et B est père de A). J'ai analysé ce type de proposition théorique dans mon premier livre, Riflessione e trascendenza. C'est typiquement la logique des rêves («dans mon rêve j'étais avec untel qui n'était pas seulement untel mais qui était aussi mon père...», négation claire du principe d'identité). Comprendre ce type de logique nous permettrait d'analyser de façon rationnelle quelque chose qui n'est pas rationnel, car cela contrevient à la logique de la rationalité. Or cela permettrait d'avoir une multiplicité de versions du monde, qui sont en contradiction mais qui ne nient pas la possibilité de mondes cohérents et rationnels. En bref: la logique serait le socle dur qui rend le discours réel.
Ce passage par la logique nous aide à comprendre le principal enjeu de la querelle entre réalisme et anti-réalisme, celui qui a été au centre des préoccupation des penseurs attaqués par Orlando: la possibilité de la différence. Car une idée trop forte de réalité détruit la possibilité de la multiplicité. Et une idée de logique unique aussi.
La question de la différence est aussi fortement liée à une autre question - qui est peut-être la raison de la durée du succès de la pensée de la différence abhorrée par Orlando: l'impact des technologies. Notre culture numérique nous plonge dans une culture de la médiation. Tout est toujours médié, il n'y a pas de réalité non médiée. Mais cela implique qu'il est plus simple de parler de discours que de parler de réalité. L'originarité de la médiation, affirmée à partir de McLuhan jusqu'à Bolter et Grusin, implique qu'il n'y a pas une source primaire qui est ensuite médiée. Or nous n'avons alors pas une unité originaire qui se manifeste ensuite sous plusieurs formes qui la représentent (comme voudrait une pensée fortement réaliste), mais une multiplicité originaire de médiations. Cette centralité de la médiation dans notre culture numérique n'était pas prise en compte par Orlando. Le débat dans le domaine de la pensée des médias semble se structurer comme une opposition entre les défenseurs d'une réalité prétechnique (la nature) - qui serait authentique et qui serait ensuite modifiée par la technique - et les défenseurs de l'originarité de la technique par rapport à la nature (il n'y a d'homme que quand il y a de la technique, il n'existe pas un homme non technique, tout dérive d'une médiation originaire, il n'y a rien avant cette médiation - cf. une certaine interprétation du mythe de Prométhée).
On pourrait donc reformuler le problème comme suit: comment est-il possible d'accepter une multiplicité originaire sans tomber dans l'aléatoire d'un discours radicalement constructiviste?
Je crois que la voie à parcourir aujourd'hui est celle de la métaontologie, concept auquel je travaille depuis mon premier livre. C'est l'idée d'une ontologie qui accepte la médiation comme structure originaire mais qui essaie, à partir de là, de faire un discours sur les essences, sur les choses et sur la réalité. On pourrait citer dans cette lignée le travail de Merleau-Ponty sur l'infra-ontologie ou celui de Badiou sur la multiplicité des ontologies (ce dernier présupposant par contre un retour à l'unité lorsqu'il s'agit de la mathématique comme une sorte de super-ontologie).
Le concept-clé de la métaontologie est l'idée de «conjoncture médiatrice», une façon d'historiciser la médiation et de l'identifier sans pour autant la réduire à cette identification (j'en ai parlé dans un autre billet).
Voilà où j'en suis. Pas très avancé, en fait...