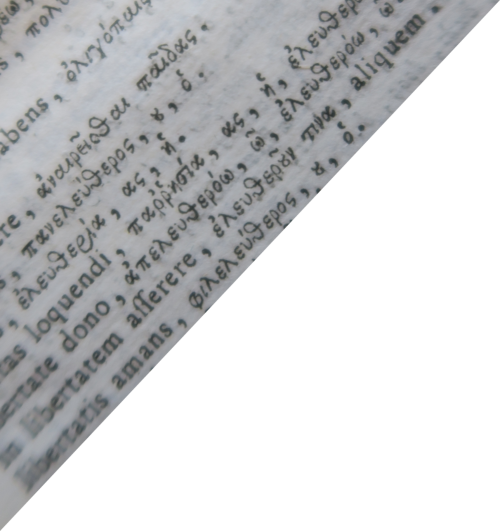
Marcello Vitali-Rosati est professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal.
Si l'on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien
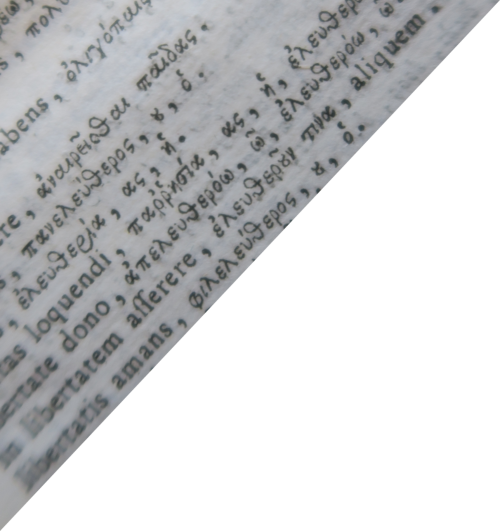
Marcello Vitali-Rosati est professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal.
Si l'on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien

2014-11-05 15:29:48-05:00
conjoncture médiatrice institution Luciano Floridi Milad Doueihi révolution numérique
Depuis quelques années, quand on me demande ce que je fais, je réponds que je m'occupe de numérique - ou de culture numérique, ou de littérature numérique. C'est vrai, au moins d'un point de vue institutionnel: j'ai été embauché sur un poste de "littérature et culture numérique". Après avoir beaucoup réfléchi à ce sujet, j'arrive à une conclusion sur la nature de ce mot: il est un symptôme d'une crise institutionnelle. Avec ce billet, je voudrais expliquer cette idée.
Désormais le mot "numérique" a envahi l'espace public. On utilise le mot dans le langage commun, on en parle beaucoup dans les médias, les institutions - gouvernements, universités, entreprises - en font un mot clé. D'abord "numérique" est utilisé comme adjectif : "document numérique", "communautés numériques", "identités numériques", "économie numérique", "environnement numérique"... jusqu'à "culture numérique". Ensuite il devient un substantif: "le numérique". Est-ce que ce mot désigne quelque chose? Le numérique, est-il quelque chose d'objectivable? Y a-t-il une essence du numérique? Bien des choses ont été écrites sur ce sujet. J'ai moi-même récemment dédié un chapitre du manuel Pratiques de l'édition numérique à une définition du numérique, Milad Doueihi a consacré ses derniers travaux à ce problème (Qu'est-ce que le numérique, La grande conversion numérique, Pour un Humanisme numérique).
On a tendance à croire qu'il s'est produit un changement important - une révolution, une rupture - à la fin du siècle passé, un changement qui a pris une importance fondamentale dans les dernières années. Ainsi, le numérique naît dans les années 1990 et acquiert une place fondamentale dans nos sociétés dans les années 2000. (La question de la révolution mériterait d'être traitée dans un autre billet. Ma position n'est pas qu'il n'y a pas de changement en cour, mais que ces changements se font dans une continuité. La rupture est épistémologique et non ontologique. À ce propos, je renvoie à deux très bons ouvrages : La grande conversion numérique de Milad Doueihi et le récent The 4th revolution de Luciano Floridi).
Ma thèse est différente - même si complémentaire : il n'y a eu aucun changement révolutionnaire dans les années 1990 - ni avant. Aucune rupture ne brise la ligne du temps et de l'histoire. Notre histoire est continue, ce sont les institutions qui changent de façon discrète. En d'autres termes: nos pratiques changent dans le temps, nous modifions nos habitudes, nos technologies, notre façon de nous rapporter au monde. Et ce changement est continu. Il ne doit pas non plus être considéré comme une évolution, car il ne va pas vers un progrès, il n'est pas téléologique. Tout simplement, nos pratiques changent. L'institution norme les pratiques en se basant sur l'état des choses à un temps déterminé. À partir du moment où l'institution cristallise ses normes, les pratiques continuent à changer, jusqu'au moment où l'institution n'arrive plus à les normer car ces pratiques sont trop différentes. C'est à ce moment qu'il faut un changement de l'institution. Et ce changement se fait d'un coup - avec le changement des normes, qui ne peut qu'être discret. C'est à se moment qu'on invente des nouveaux mots pour qualifier le changement. Et c'est à ce moment qu'on commence à parler de révolution. Il y a donc révolution, mais dans l'institution et non pas dans les pratiques.
Considérons quelques exemples. Les dispositifs institutionnels qui norment le domaine de l'édition se sont mis en place au XVIII siècle. Il est intéressant de remarquer qu'au moins 250/300 ans séparent l'invention de Guttemberg de la création des institutions. C'est au XVIII siècle que le copyright est mis en place, que les pratiques sont normées, que l'édition devient une pratique cadrée. Les maisons d'édition deviennent des institutions. Les états créent des lois pour régir ces pratiques. L'institution permet de normer et de donner un sens à ces pratiques - mais aussi de leur donner un nom. Or depuis le XVIII siècle les pratiques ont progressivement changé. Le sens qu'on donne aux mots a changé, l'importance que l'on donne à l'auteur a changé - par exemple dans les années 1960 - les techniques ont changé, le lectorat, le nombre de personnes sachant lire, les conditions économiques, sociales etc. Ces changements créent un malaise à l'intérieur de l'institution, car ses normes ne correspondent plus à la réalité des pratiques: les pratiques s'éloignent de plus en plus de la façon qu'a l'institution de les représenter et de les réguler. C'est à ce moment que la crise se déclenche. C'est à ce moment qu'on a besoin d'un changement institutionnel. Le symptôme de cette crise et de ce besoin de changement est le mot numérique, avec lequel on nomme l'écart entre les pratiques réelles et les pratiques telles que normées par l'institution. En ce sens l'expression "édition numérique" nomme tous les changements continus qui séparent l'édition du XVIII siècle avec les pratiques éditoriales d'aujourd'hui. Avec l'expression "édition numérique" les institutions essayent de faire un nouveau point sur l'état des pratiques pour être capables de les normer à nouveau et de pouvoir continuer à les gérer. Nous sommes dans un moment d'institutionnalisation.
Le même discours vaut pour un grand nombre d'institutions: pensons à la gestion de l'identité personnelle, pensons à l'enseignement, à la recherche, à l'art, à la communication. Dans le cas de mon poste à l'université: on parle de littérature pour désigner un certain nombre de pratiques qui se sont cristallisées dans les années et les siècles. Ces pratiques évoluent jusqu'au moment où la différence entre ce qu'on entend par littérature et ce que sont les réelles pratiques est trop importante pour ne pas poser problème. L'université ne sait pas quoi faire des pratiques qui ne rentrent pas dans le cadre institutionnel: elle commence donc à utiliser le mot "numérique". En ce sens, le numérique n'a rien - ou très peu - affaire avec les ordinateurs. Il se trouve que l'informatique à joué un rôle dans le changements de nos pratiques, mais ce n'est pas le rôle principal, et surtout pas le seul. C'est pourquoi, finalement, par littérature numérique on peut entendre non pas la littérature faite avec des ordinateurs, mais plutôt la littérature à l'époque des ordinateurs. L'expression "littérature numérique" pourrait tranquillement être substituée avec l'expression "littérature actuelle". Ce sont, en d'autres mots, les pratiques qui ont probablement un rapport avec la littérature mais qui divergent trop des pratiques institutionnalisées pour qu'on puisse les appeler "littérature contemporaine".
Or cela pose une série de question sur le processus de normalisation des pratiques, sur le rôle des institutions, sur leur place dans la société. Les institutions sont par nature toujours en retard. Elles fondent leur normalisation sur quelque chose qui est toujours, par définition, dépassé. Les pratiques sont toujours au delà de l'institué, elles sont toujours chargées d'un caractère institutionnalisant, à savoir créatif et normatif. À chaque fois que quelqu'un fait de la littérature il fait quelque chose qui n'est pas vraiment ce qu'on entend par littérature mais qui redéfinit le sens de "littérature". Et cette créativité met l'institué en échec. À chaque fois, l'institution essaie de rattraper son retard en changeant. Ce changement c'est ce qu'on peut appeler "institutionnalisation" ou "normalisation" ou encore "naturalisation". Dans le cas de la littérature numérique, l'institutionnalisation consiste par exemple à créer un poste de "littérature et culture numérique", ainsi qu'à créer des prix de "littérature numérique", des cours, des associations, des éditeurs qui font de la "littérature numérique" et ainsi de suite. Cette institutionnalisation implique que les pratiques nouvelles ne semblent plus étranges et déviantes. Elles deviennent normales. Cela implique aussi qu'il y a une normativité qui apparaît. On commence à savoir ce qu'est la "littérature numérique" et donc ce qu'elle "doit" être. Avant d'être institutionnalisées les pratiques divergentes n'ont rien de normatif: tout simplement ce sont des pratiques qui ne rentrent pas dans des définitions institutionnelles. Mais après l'institutionnalisation, elles commencent à être normées, réglées: on sait ce qu'on doit faire si on veut pouvoir appliquer à un poste de "littérature et culture numérique", quel cv il faudra avoir, sur quelles revues il faudra avoir publié. Cela implique que les pratiques créatives et innovantes finiront par sortir de cette définition et se retrouver à nouveau en marge de l'institution.
Mais bien sûr la phase de normalisation est nécessaire pour pouvoir organiser notre société. Or il y a deux manières de normaliser des pratiques: une diachronique et l'autre synchronique. Je m'explique. On peut essayer de normer un nombre très limité de pratiques dans une durée très longue (diachronique) ou un nombre très élevé de pratiques dans une durée de temps très courte (synchronique).
Pensons à la définition de pratiques qu'on regroupe sous le nom de théâtre. On constate que les êtres humains dans plusieurs sociétés et depuis plusieurs siècles font une chose particulière et très spécifique: ils exposent des actions. On remarque que très souvent cette exposition d'actions se fait dans un cadre prédéfini, on remarque le rôle social de cette exposition d'actions et l'ensemble des dispositifs (techniques, culturels, anthropologiques) qui règlent ces pratiques. On appelle tout cela "théâtre". Avec ce mot on essaie aussi de définir ce qu'est le théâtre et de le structurer. De le comprendre et de le normer pour pouvoir gérer son rôle dans la société. C'est à partir de cette institutionnalisation qu'on peut créer des théâtres, des systèmes pour subventionner les créations théâtrales, des programmes d'enseignement de théâtre et ainsi de suite. Le même raisonnement vaut pour la littérature, le cinéma, la télévision, la radio. Il s'agit de définitions diachroniques de pratiques bien précises. Bien évidemment l'institutionnalisation est un arrêt sur image: il s'agit de faire abstraction des différences entre un ensemble hétérogène de pratiques pour les mettre dans un même groupe et les nommer. On pourrait utiliser une marge de tolérance de la différence plus ou moins importante pour rassembler un nombre plus ou moins élevé de pratiques (par exemple en disant "activités culturelles" on regrouperait des pratiques "littéraires" "théâtrales", "cinématographiques" etc.).
L'institutionnalisation synchronique consiste à prendre un nombre de pratiques très élevé et dans un temps très court. Très souvent on entend de cette manière ce qu'on dénomme "culture", par exemple la culture d'une époque. L'humanisme, en tant que culture qui caractérise le XV siècle regroupe une série de pratiques très hétérogènes mais qui sont caractérisées par un dénominateur commun, une espèce d'"esprit de l'époque". On pourrait dire que les cultures religieuses rentrent aussi dans ce type d'institutionnalisation, même si dans le cas de la religion, on met ensemble une vision synchronique et une diachronique. Mais d'un certain point de vue, on pourrait affirmer que l'important c'est d'abord d'uniformiser un nombre très élevé de pratiques à l'instant présent. L'important est que tous les chrétiens aujourd'hui se comportent de la même manière en une situation déterminée. Le fait qu'il y a cent ans les choses étaient différentes ne compte pas vraiment. Je m'explique: bien évidemment les actions quotidiennes d'un chrétien d'il y a cent ans étaient très différentes des actions d'un chrétien d'aujourd'hui, tout simplement parce que l'environnement, les enjeux sociaux etc. n'étaient pas les mêmes. Mais le fait d'être chrétien aujourd"hui touche à l'ensemble de pratiques possibles (on est chrétien quand on mange, quand on fait de l'art, quand on travaille etc.).
Le numérique tend à fonctionner de la même manière - comme le souligne Milad Doueihi dans son "La grande conversion numérique". Avec le mot "numérique" on définit un ensemble très hétérogène de pratiques qui ont comme dénominateur commun le fait d'avoir lieu dans notre présent historique. En utilisant ce mot on a tendance à faire converger toutes ces pratiques, même si elles sont très différentes: poster une photo sur facebook ou écrire un article savant, acheter un billet d'avion pour aller en vacances ou live-twitter pendant un concert de rock... Cette convergence a été analysée - par exemple par Henri Jenkins dans son Convergence culture - comme une caractéristique de la culture actuelle. Cela est vrai et faux en même temps. C'est vrai d'un point de vue institutionnel: le discours sur le numérique a tendance à comprendre un ensemble très hétérogène de pratiques comme une unité, et donc il les fait converger. Dans le discours institutionnel je m'occupe de "numérique" ce qui signifie qu'on va me demander mon avis sur les stratégies d'achat de serveurs de Google comme sur les problèmes psychologiques des adolescents utilisant facebook ou du dernier livre de Houellebecq qui plagiait Wikipédia. Ce qui relevé de plusieurs domaines disciplinaires différents converge aujourd'hui en un seul domaine: "le numérique".
C'est faux car les pratiques en elles-mêmes ne convergent pas plus aujourd'hui qu'elles ne convergeaient il y a cent ans ou il y a deux milles ans. C'est juste notre façon de les nommer et de les comprendre d'un point de vue institutionnel qui a changé.
Je vais essayer maintenant de mieux formaliser ce que je viens de proposer. Tout d'abord, je vais donner une définition: par "pratique" j'entends des caractères communs à des actions différentes. Un agent A fait un action X, un agent B fait un action Y. X et Y sont des actions caractérisées par une série d'éléments: un contexte (C), une situation spatiale (S), un temps (T), une série d'idées et d'idéologies (I), des appareils médiatiques (M) et ainsi de suite. Quand un ou plusieurs de ces éléments sont équivalents - ou semblables - on peut parler de pratique. Admettons que X et Y partage C et M, on parlera d'une pratique CM.
Voici un exemple. Luca (A) le 4 avril 2015 à 16h prend une photo de Montréal depuis le belvedere sur la montagne (action X). Jean, le 20 juin 2014 prend une photo de la tour Eiffel depuis le champs de Mars (action Y).
On peut trouver des éléments communs à ces deux actions. Il s'agit d'appareils technologiques analogues (même si l'on n'a pas spécifié avec quel appareil Luca et Jean ont pris leurs photos), il s'agit de prendre en photo un paysage etc. On peut parler d'une pratique "photographique". Bien évidemment, selon les éléments que l'on prend en compte, les pratiques peuvent être regroupées de façon plus ou moins large et précise. On pourrait dire que l'action "Léonard peint un paysage florentin en 1510" (action Z) partage des éléments avec les deux actions précédentes et on pourrait parler d'une pratique de "représentation du paysage". Ou alors on pourrait vouloir préciser avec quel appareil Luca et Jean ont pris leur photo et spécifier qu'il s'agit de téléphones intelligent et définir la pratique comme "photo numérique mobile".
La spécification des éléments communs qui servent à définir une pratique est la façon qu'a l'institution de normaliser ces pratiques. Cette spécification est ce que, avec Jean-Marc Larrue, j'appelle "conjoncture médiatrice".
Pour revenir au numérique: j'ai l'impression qu'avec le mot numérique on veut regrouper de façon synchronique des pratiques très hétérogènes et que ce regroupement sert justement à souligner la divergence des pratiques actuelles avec l'ensemble des pratiques institutionnalisées.
Nous sommes donc dans un processus d'institutionnalisation. Il nous faudra beaucoup de théorie pour que l'on puisse arriver à la définition d'objets institutionnels un peu plus clairs et un peu plus utiles. Pour l'instant nous n'en sommes qu'au début.
----------------------------------
J'ajoute ici (le 19 novembre) un commentaire qui m'a été envoyé par Roberto Gac par email. À cause du spam j'ai été obligé de bloquer les commentaires sur le site, J'invite tous ceux qui en ont envie à m'écrire par email.
Voici le courriel de Roberto
Caro Marcello,
[...]
Le titre "Le numérique n'existe pas", délicieusement provocateur, me semble digne d'un roman, mais impossible pour un Intertexte car sans le numérique le nouveau genre narratif n'existerait pas. Or, ce qui est louable dans ta démarche de penseur, c'est ta capacité à relativiser tes propres concepts. Ainsi, dans le compte rendu sur le livre de Rémy Rieffel Révolution numérique, révolution culturelle?, que tu voulais voir publié rapidement par SP, l'auteur prend apparemment à contrepied tes idées à propos de la "non rupture" et de la "non révolution" impliquées par le soi-disant "numérique". C'est vrai, il faut se poser et reposer la question sur la signification véritable de ces termes. En tout état de cause, je suis d'accord avec toi sur le fait qu' une simple invention technique comme l'imprimerie ou très complexe comme l'écriture électronique, ne suffisent pas à elles seules pour constituer une rupture "ontologique" (selon tes termes) et, encore moins, une révolution. Ce serait presque aussi tragicomique que de prétendre que l'invention de la guillotine a permis la révolution de 1789 !
En réalité, il ne s'agit là que d'instruments qui vont rendre possible la vraie rupture, la véritable révolution qui, en très peu de temps, va bouleverser l'ancien état des choses, devenu intolérable et inefficace (je plaisante pour la guillotine, bien sûr, quoique, machine à tuer vraiment révolutionnaire, elle ait soulagé bourreaux et victimes). Donc, le "numérique" (acceptons ce terme par commodité) n'est que l'outil génial qui, comme jadis l'invention de Gutenberg, permettra aux hommes (et aussi aux femmes) de provoquer une rupture, de réussir une révolution culturelle universelle. L'action de Sens Public s'inscrit courageusement dans ce sens, tu en conviendras.
J'aime bien ta façon de t'exposer personnellement dans tes réflexions. Cela leur donne une qualité d'authenticité et de vitalité plutôt rares chez les penseurs (et tu en es un, comme Baktine, qui aimait être considéré comme tel). Or, d'après ta propre description, tu es professeur de "littérature et du numérique". Précisément, si je peux me permettre une critique de ta pensée, je dirais que, dans l'état actuel de son développement, elle est largement déséquilibrée au profit du numérique et au détriment de la littérature. Peut-être est-ce la raison qui explique pourquoi tu ne vois pas que le numérique n'est que l'instrument d'une rupture et d'une révolution "multifacética", qui touche à beaucoup d'aspects de la vie humaine... y compris la littérature.
Je finis cette brève et très amicale "dispute" en revenant un instant au texte d' Élisabeth Routhier [voici le lien] sur le roman de ton compatriote Alessandro Baricco, Oceano Mare.... Mme Routhier dit des choses magnifiques sur cet ouvrage où elle voit que "...le texte romanesque, bien qu’appartenant à ce que l’on considère comme un « média traditionnel », peut [...] être abordé comme un milieu où des actions et interactions peuvent se déployer, malgré l’apparente fixité de ses structures. Plutôt que représentés, les objets sont médiés – mis en médiation – et les jeux sur les modes et aspects des médias peuvent créer des moments de remédiation qui accroissent le dynamisme de ces objets". En réalité elle ne parle plus du roman comme genre littéraire, dont les structures sont immuablement fixes. Elle imagine, à son insu, un autre genre narratif, l'Intertexte, à la structure totalement flexible et modifiable par son lecteur même, mais non dans l'intimité de son imagination, sinon dans la matérialité textuelle de l’œuvre. Voilà (j'insiste une fois encore) la différence essentielle entre le roman et l'intertexte. Et ce nouveau genre narratif révolutionnaire existe déjà grâce au "numérique" et... à Sens Public. En attendant que mes collègues francophones s'intéressent au phénomène (certes, je ne suis pas né à Paris et jamais je ne me suis rendu aux séminaires d'un Barthes ou d'un Lacan, ce qui peut me rendre intellectuellement suspect, je sais bien), mon œuvre en français et en espagnol commence à être étudiée au Chili. Le professeur David Wallace, directeur du Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, s'en occupe avec ses étudiants (séminaires, thèses, entretiens, etc.) Tu peux suivre un peu cela dans mon website [voici le lien]. Je viens de faire rééditer, à leur demande, les deux premiers tomes de ma pentalogie -"Les Phases de la Guérison"- El Bautismo et El Sueño. J'ai parlé à David Wallace du séminaire sur l'éditorialisation réalisé par Sens Public au Centre Pompidou et de ton labeur comme professeur à l'université de Montréal. Peut-être une collaboration autour des nouvelles modalités narratives issues du numérique s'amorce à l'horizon. Souhaitons-le, cher Marcello.
Bien amicalement
Roberto