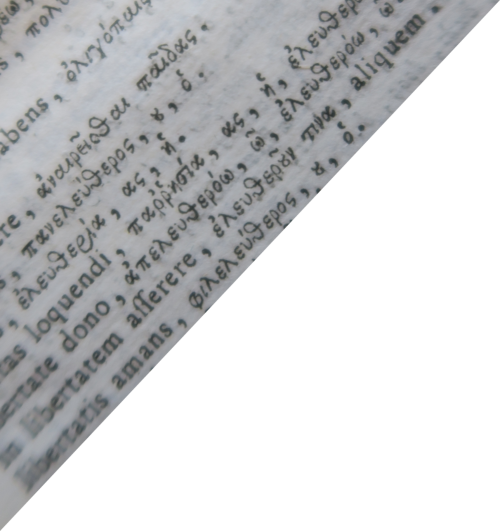
Marcello Vitali-Rosati est professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal.
Si l'on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien
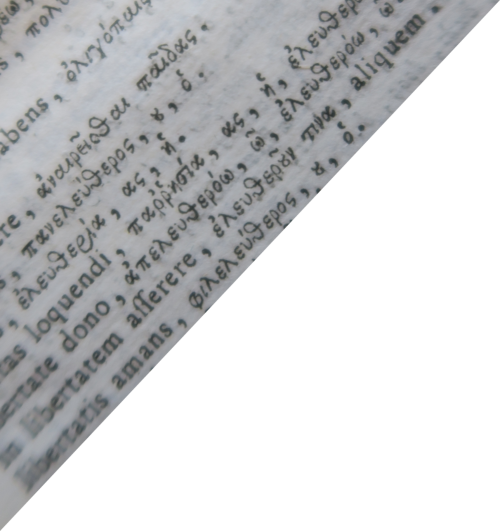
Marcello Vitali-Rosati est professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal.
Si l'on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien

2020-04-06 18:03:41-04:00
coronavirus humanisme posthumanisme

Marcello Vitali-Rosati, Université de Montréal
« Vous vous êtes toujours demandé comment c’était de vivre au Moyen-âge ? Maintenant vous avez deux papes et une épidémie. » Voilà le genre de blague qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux italiens.
Il y a du vrai dans cette boutade : certaines valeurs de la modernité sont profondément remises en question, avec le retour de structures de pensée que l’on croyait révolues depuis l’époque médiévale. Les politiques d’isolement pour faire face à l’urgence sanitaire en sont un exemple.
Eugenio Garin soulignait que la philosophie de l’humanisme ne cherchait pas à construire de grandes cathédrales d’idées, contrairement à la philosophie médiévale. La spéculation métaphysique de la scolastique était remplacée par un intérêt pour des questions beaucoup plus concrètes : la morale, la politique, les sciences de la nature. Des réflexions, donc, à mesure d’homme. La grande rupture entre le Moyen-âge et l’humanisme consiste justement à mettre en question la position des êtres humains dans l’univers. Dans l’univers médiéval, l’homme a été créé à l’image et selon la ressemblance de Dieu, et cela implique que la philosophie doive s’occuper de la structure profonde du monde duquel l’homme est donc le centre – en tant qu’il est à l’image de Dieu.
Si les grandes cathédrales d’idées sont possibles, c’est grâce à la position que les hommes occupent dans l’univers. L’humanisme est un moment de grande humilité, par rapport à cette idée médiévale : les êtres humains ne se considèrent plus au centre de l’univers, mais juste comme des êtres humains. La philosophie s’intéresse donc aux choses humaines et délaisse les grandes idées métaphysiques.
Ce changement de point de vue a une double signification : si d’une part il implique justement une certaine humilité – les êtres humains ne sont plus au centre de l’univers – de l’autre il implique une nouvelle importance, toute particulière, donnée à l’espèce humaine : au Moyen-âge l’homme n’était important que parce qu » il était à l’image de Dieu ; à partir du XVe siècle l’importance du genre humain est absolue, indépendante de sa position. Si pendant le Moyen-âge les choses humaines n’étaient en elles-mêmes que vanitas, pour les humanistes elles ont un intérêt certain. L’homme n’est plus au centre du monde, mais il est au centre de nos intérêts d’êtres humains.
Cela a beaucoup de conséquences : une attention nouvelle pour les humanae litterae – écrire des textes est justement une activité spécifiquement humaine –, une démarche d’historicisation du monde – l’histoire et la chronologie humaine n’ont pas beaucoup d’intérêt d’un point de vue métaphysique, mais elles l’ont d’un point de vue, justement, humain –, une concentration sur l’individu, une volonté de bien-être…
Il y a donc un changement radical d’échelle : on ne regarde plus à l’univers dans sa chronologie éternelle où les êtres humains sont un petit point insignifiant – et qui ne peut avoir du sens que s’il est justifié par un rapport privilégié avec la divinité – on regarde à l’échelle des êtres humains : le temps et l’espace humains commencent à compter, à être la seule chose qui compte.
Cette révolution humaniste est celle qui a porté à la fin de la métaphysique d’une part – on ne s’intéresse qu’à ce qui est à mesure humaine, tout le reste ne peut pas être pensé par des humains et n’est donc que dogme (comme dans la tradition kantienne depuis la Critique de la raison pure) – et à l’émergence de l’individu moderne comme le centre d’intérêt de la pensée et des activités humaines. Ce discours est lié à une volonté d’optimisme : l’importance absolue de l’humain implique que le seul espoir peut être celui d’une amélioration progressive de la situation des êtres humains dans leur temps et dans leur espace.
Cette volonté d’optimisme, fondée sur révolution humaniste, trouve son expression la plus accomplie quelques siècles plus tard dans l’idée de progrès des Lumières. Les choses vont aller de mieux en mieux, la science va nous aider à attendre cet objectif. Ce qui pouvait être avant un objectif se réalisant dans une transcendance – la vie éternelle – devient une nécessité immanente : il faut que le salut se réalise dans le temps et dans l’espace humain.
Nous vivons aujourd’hui un changement analogue et symétrique à celui qui s’est produit au XVe siècle et ce pour plusieurs raisons. Une – qui me semble fondamentale, mais dont je ne parlerai pas longtemps ici – est le changement du rapport au texte. Comme au XVe siècle la reconsidération de la définition d’humanité passait par une reconfiguration du rapport aux textes – les êtres humains sont d’abord les producteurs et les lecteurs de textes, des humanae litterae – aujourd’hui, le sens du texte change avec l’émergence d’acteurs différents dans sa production et dans sa circulation : ce qu’on appelle des machines. Le rapport « homme-machine » exige de repenser ce qu’est l’humain.
Une autre raison est que, l’optimisme et l’idée de progrès qui doit accompagner le modèle humaniste ne semble plus être possible. Il ne semble plus possible de penser que le salut se réalisera dans l’immanence, il ne semble plus possible de penser que les choses continueront à aller de mieux en mieux. Au contraire, il semblerait que le futur soit destiné à être moins bon que le passé. L’existence même de l’espèce humaine est clairement menacée. L’urgence climatique, l’effondrement progressif des idéaux démocratiques, l’épuisement des ressources énergétiques et dernièrement l’éclatement d’une épidémie que les infrastructures sanitaires ne sont pas en mesure de contrôler sont d’autant de signaux qui rendent désormais impossible le paradigme du progrès infini. L’optimisme technologique est lui aussi arrivé à sa fin : après des années de rêves, la technologie semble représenter dans l’imaginaire collectif plus une menace qu’une promesse. Dans cette situation il est difficile de vouloir se concentrer sur l’humain. L’humain a peu de chances de rester, il a peu de chances d’avoir un intérêt quelconque dans un futur pas trop loin.
L’humain tel qu’il s’est défini à partir du XVesiècle ne peut plus prétendre revêtir une importance suffisante pour se placer au centre de nos préoccupations. Il faut le définir autrement ou alors se préoccuper de quelque chose d’autre. Deux tendances complémentaires se dessinent à partir de ce constant : la nécessité de penser l’humain autrement et la réémergence de formes de pensée que l’on peut caractériser de métaphysiques.
La première tendance est ce qu’on appelle – désormais depuis plus de vingt ans – « posthumanisme ». À l’opposé du « transhumanisme » courant de pensée qui radicalise l’idée de progrès en imaginant une humanité augmentée et perfectionnée par la technologie – ce qui semble clairement grotesque aujourd’hui –, le posthumanisme essaie non pas d’aller au-delà de l’humain, mais au-delà de l’humanisme à savoir de l’idée d’un genre humain, bien défini et identifiable, qui serait finalement tout ce dont il vaut la peine de s’occuper. Au lieu que de s’occuper des choses « humaines », il est nécessaire de réfléchir à nouveau sur ce qu’est et sur ce que peut être l’humain et sur quelle place cet humain peut et doit avoir dans l’univers. Cela permet de questionner la centralité de la question humaine, de revoir les définitions et les essentialisations qui ont cristallisé des idées sur les rapports entre espèces, entre genres ainsi que les rapports à l’environnement. Je crois que plus que parler de « post » humanisme, il faudrait plutôt parler de « pré » humanisme, car justement il s’agit de revenir à la définition de l’humain telle qu’elle a été dessinée par l’humanisme ; mais aussi parce qu’il faut remonter « avant » l’humain et ses intérêts pour redéfinir de nouvelles préoccupations et de nouveaux objectifs.
La seconde tendance est celle d’un retour à la métaphysique – ce qui peut être facilement constaté en analysant de courants philosophiques comme le « nouveau materialisme » (DeLanda), le « nouveau réalisme » (Ferraris), le « réalisme spéculatif » (Meillassoux) et d’autres formes analogues de réflexion. Selon ces mouvements, la critique kantienne – à savoir l’idée selon laquelle nous ne pouvons parler rigoureusement que du monde tel que nous le connaissons et pas du monde en tant que tel, car ce dernier n’est qu’une présupposition dogmatique – a impliqué une perte progressive du réel : il n’y a plus le réel il n’y a que ce que le sujet humain voit du réel, son rapport au réel. Il faut, selon ces mouvements, revenir au réel. Et donc finalement, revenir à la métaphysique en mettant en question le rôle central et incontournable de l’humain comme mesure unique du réel.
Pourquoi parler de tout cela au moment de la crise liée au coronavirus ? Les épidémies nous renvoient, comme au Moyen-âge à la notion selon laquelle les « choses humaines » ne sont que vanitas. Il est donc nécessaire de s’interroger à nouveau sur ce qu’est l’humain, sur sa place dans l’univers, sur ses relations avec les autres êtres et les autres choses qui le remplissent.
Cette réflexion est urgente aujourd’hui et elle peut conduire à des solutions très différentes : un retour à la religion ou à la superstition d’une part, et de l’autre le développement d’une pensée proprement « inhumaine ». C’est cette dernière qui me semblerait la solution à chercher dans la mesure où une pensée inhumaine serait une pensée dans laquelle l’être humain n’est pas le centre, ni le producteur, ni l’objectif de la réflexion. Une pensée inhumaine – ou préhumaine pour utiliser un terme moins agressif – serait une pensée qui à partir de la crise actuelle essaie de retrouver l’aspect humble de l’humanisme en laissant tomber la contrepartie d’arrogance qu’il a pu comporter.![]()
Marcello Vitali-Rosati, Professeur agrégé au département des littératures de langue française, Université de Montréal
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.